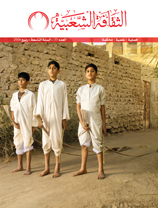Entre Conte Populaire Et Mort De L’auteur
Issue 11

Le contradicteur a-t-il posé la question de la nature du récit et de ses visées esthétiques, lorsqu’il s’agit du conte, qui est un genre narratif plus ancien ? S’est-il, à partir de là, interrogé sur la signification réelle de la notion de « mort de l’auteur », sur son histoire, sur le sens et les finalités que lui donne son auteur, ou, de façon plus générale, sur l’opérationnalité de cette notion ?
Une première approche, plutôt cahoteuse, de la structure du rapport entre les deux termes nous met en présence d’un monde plus stimulant, plus exaltant, qui est de nature à modifier le contexte même de l’équation, laquelle est orientée dans une seule direction, avec ce que cela suppose de schématisme, d’excessive généralisation et de paradoxe abusif, mais aussi avec tout l’accent qui est mis sur la fécondité du conte populaire – plus ancien dans le temps que toute tentative de théorisation.
Du reste, en nous penchant sur le conte populaire, nous ne faisons que rectifier la situation d’un rapport culturel, tout en prenant en considération des forces ayant un impact sur notre formation psychique, éthique et vitale. Nous élargissons, à cet égard, le concept de temps, tout autant que nous ouvrons le dossier de la «mort de l’auteur »,
en tant qu’il recouvre une notion qui n’est pas sans rapport avec la dynamique signifiante du conte populaire. Le signe révélateur du côté matriciel du conte, qui a longtemps été passé sous silence, est un signe de caractère positif, et ôte à ceux qui ont cru en la modernité de la notion de « mort de l’auteur » le caractère avant-gardiste de leur proposition ou tout ce qui est de nature à la présenter comme une initiative toute neuve et surprenante dans sa signification, comme s’ils avaient fait surgir cette notion ex nihilo, alors que le conte populaire, dans sa signification première comme dans son sens profond, apparaît comme existant par lui-même, concrètement, et ne peut en fait que regarder ces propositions en les soulignant d’un rire moqueur retentissant.
Nulle nationalité, donc, à ce type de conte, dès lors que l’on s’arrête à sa composante essentielle et que l’on s’interroge sur les récits similaires ou comparables, ce qui est par excellence le travail des ethnographes. Car, tout conte – dès qu’on emploie ce vocable – nous renvoie à un récit qui dépasse l’énonciateur et l’archiviste, et fait écho aux autres contes auxquels il se trouve uni par la même thématique. La langue n’est rien de plus qu’un emblème corporel et le son qui en est l’actualisation n’est rien d’autre qu’un médium qui la sort de son mutisme, car le latent c’est la langue et ce qu’elle n’a pas énoncé – la langue qui est, dans les limites qui sont les siennes, plus loin que l’autorité des nominations.
Le conte est donc un récit unificateur de destins. Guère d’Histoire (ou de chronologie) précise du conte populaire. Car celui-ci s’enfonce au plus profond des âges et incite l’Histoire à une plus grande dynamique, une ouverture accrue, les frontières du conte constituant l’univers propre à ce conte et ceux qui s’y meuvent, alors que l’Histoire obéit à d’autres lois, au point que, bien souvent, elle se trouve en opposition avec le conte populaire. Le conte, tout conte, est stratégiquement producteur d’effet, ne serait-ce que lorsqu’il est vu sous un certain angle.
Il existe des contes « à impact immédiat », si l’on peut dire, impact qui dépasse les limites de ceux qui en sont directement concernés, sans les occulter pour autant. Voilà un effet que le « nom » ne peut produire, j’entends le nom trilitère de l’auteur, et peutêtre aussi une autre marque le caractérisant, des procédures de conservation de ce nom, de la langue et de l’environnement de l’auteur.
Or, le nom a droit à un statut donné, au sein du conte, qui fait que la proposition (ou l’appel à) la « mort de l’auteur » est une pure modalité narrative, quand bien même on n’en ferait pas l’aveu. Le conte populaire, qui est le lieu de convergence et la finalité de toutes les formes narratives, est ouvert au renouvellement à travers la découverte toujours recommencée de ses « fibres intimes », expression qui désigne ce qui en est resté innommé et que nous empruntons au concept scientifique désignant toute matière vivante.
Ces fibres sont appelées par les scientifiques « silicon » ; elles stockent en effet ce qui est de nature à redonner vie à des temps historiques différents et traversés par des tendances antagoniques. L’auteur, même si son nom a disparu ou a été occulté ou effacé, est suivi à la trace par ses écrits. Son style le désigne par son nom. Ou alors c’est lui-même qui n’a de cesse de chercher ces stimulants et ces passerelles qui le relient à son texte, à son devenir, à son aire de diffusion, à la façon dont son texte sera reçu.
Le conte est loin de toutes ces considérations : il est, dans son essence même, les autres, j’entends ceux qui sont dans la matrice du récit, en tant que potentiel épique, solidaire en ses éléments, non pas de façon frontale mais de façon additionnelle, contrairement au texte attribué à un nom et oblitéré par une signature précise, de sorte qu’il reste, en surface comme en profondeur, lié à ce nom.
On peut dire que quiconque entreprend de leurrer le lecteur pour dynamiser le processus de la lecture ne fait qu’accroître la part de l’auteur dans ce processus. Il existe un rapport entre les deux concepts de narration et d’assertion, d’un côté, et la place qu’occupe entre ces concepts la notion de « mort de l’auteur ».
La narration atténue l’emprise du présent et oriente l’attention vers l’imaginaire. C’est tout à la fois une leçon de convergence et de divergence. L’auteur lui-même n’est pas étranger à la volonté d’influer sur le récepteur qui est dans tout acte narratif. Mais ce que l’on peut déceler à ce niveau est de l’ordre de la création ou de la revivification de la mémoire sensible. En partant de ce qui précède, le concept d’assertion est susceptible d’enrichir ce rapport, car l’assertion (on affirme que… il se dit que…) est plus proche de la présomption.
Le nommé (le nom de l’auteur) n’en est pas pour autant au-dessus de tout soupçon, ou n’en échappe pas pour autant aux mirages de l’illusion, et c’est ce qui permet à l’autre d’intervenir, en interagissant avec le récit comme s’il était le sien propre.
L’assertion est, dans ce cas, l’une des manifestations du récit propre à stimuler la curiosité quant à l’identité du destinateur ; la narration (dans le récit du type : « On raconte que… ») ne suppose pas une interrogation sur ce qui murmure – se dit entre les lignes – de la narration car le récit nous renvoie à un absent et laisse le choix au lecteur ou à tout autre type de récepteur de poursuivre ou non sa lecture ou son écoute. Ecriture palimpseste, écriture sur l’écriture, mais qui ne peut éliminer la première écriture, éliminer ou réduire au silence la source d’inspiration, car les voix qui ont rempli l’horizon de l’ensemble des contes enchevêtrés se caractérisent par l’habileté du « feeding » symbolique et la capacité à exercer un attrait puissant, quand bien même le conte serait traduit en d’autres langues.
Nous ne croyons pas être dans l’erreur, sur la base de ce qui précède, en affirmant qu’il n’existe pas de romancier ou de conteur qui se soit préoccupé de ce qui est étranger à son propos. Les Mille et une nuits n’ont pas eu jusqu’à présent le moindre soupçon d’influence sur la sensibilité de l’auteur, ou son monde personnel, de sorte que la formule « mort de l’auteur » relèverait de l’utopie moderniste, et reste inadaptée aux assemblées festives et à l’écoute attentive des contes. Ici, et juste à ce stade, la notion de « mort de l’auteur » demeure indissociable de ce qui de l’ordre du récit raconté et de ce qui vit de la richesse de son univers illimité !
Ibrahim Mahmoud (Syrie)